Esprit Critique - Newsletter de la Fondation Jean-Jaurès - N° 45, octobre 2004
Article paru à l'occasion de la rentrée littéraire 2004
____________________________________________
Si l’on pare bien souvent la France du beau nom de « pays de la littérature » (Pierre Lepape), notre hexagone très lettré semble également trouver motif à se réjouir d’être le champion toutes catégories des rentrées et prix littéraires. Ainsi, tels de bons écoliers qui y auraient consacré leurs devoirs de vacances, les écrivains de ce pays y sont priés de rendre leurs rédactions à l’heure afin que les conseils de classe, composés eux-mêmes de plumitifs (parfois) émérites, disposent de suffisamment de temps devant eux pour parcourir les copies, décider de l’ordre définitif du classement et de l’attribution subséquente des prix. Vu de l’étranger, c’est-à-dire du monde entier, ce petit barnum de la concurrence intra et infra-littéraire a de quoi faire sourire. D’autant qu’au vu de la multiplication des récompenses, sucettes et autres sédatifs, chaque écrivain de l’hexagone ne tardera plus à pouvoir se vanter d’être lui-même détenteur d’un tel ornement (qu’il se nomme Goncourt ou bourse d’encouragement de la société des gens de lettres de Gif-sur-Yvette). Bref : ladite compétition des génies n’est pas nécessairement ni systématiquement très digne de la profession, nul besoin d’être un militant acharné de l’altermondialisation ou de l’anéantissement total de la primauté du marché pour en convenir. Mais le succès est là, indéniable : la bousculade de septembre ayant atteint, voire dépassé le niveau maximal du tintamarre acceptable (dit aussi « seuil de tolérance »), une seconde rentrée fut bientôt inventée, en janvier, laquelle, selon toute probabilité, devra elle-même se scinder en une troisième joyeuse et rentable occurrence (pourquoi pas en avril, après le retour des cloches ?).
Mon propos est un peu convenu, je n’en disconviens pas. Il n’en demeure pas moins que la montée en puissance du spectacle littéraire n’induit nullement une amélioration systémique de notre littérature : ce n’est pas parce que Danone multiplie ses sous-marques que les yaourts français s’exportent mieux, ni que leur qualité en soit plus incontestable encore (de toute façon, ils ont toujours été délicieux). Enfin, mais je vous épargnerai ma tirade sur le sujet, il semblerait (je dis bien : il semblerait) que la liste des nominés aux différents prix mentionnés ne soit pas toujours de la meilleure tenue. Et en effet, je suis toujours un peu surpris d’y lire, entre deux huitres aux perles précieuses, le nom de quelques bigorneaux à coquilles écornées. Mais ce sont là les limites naturelles du marché : j’enjoins chacun à accepter ce dommage collatéral inhérent à toute saine émulation.
De quoi se plaint-il ?, demandera le lecteur impartial mais optimiste : la surproduction littéraire, la multiplication des prix, des lecteurs, des couvertures de magazines, le coup de fouet à l’économie nationale, l’image et le rôle et la grandeur et la sublimité de la France dans le monde, tout cela n’est-il pas finalement la preuve de notre dynamisme culturel, de notre incontestable réputation d’incontestés ? Peut-être. Peut-être, après tout, devrions-nous chasser ces quelques ombres du sarcasme dépressif et nous réjouir de ces feuilles d’automne qui tombent par milliers et se ramassent comme elles peuvent. Peut-être, oui, devrais-je me réjouir de l’existence de ces centaines de romans ignorés, dont je rappelle que chacun requit de son auteur quelques nuits et mois d’humeurs contingentes. Alors disons simplement que j’ai une pensée émue pour celui qui verra paraître son livre le même jour que celui de tel gros étalon de telle grosse écurie, et que le million de dollars d’à-valoir d’Hillary Clinton vaut bien quelques larmes dédiées au scribe morose et forcené qui survit comme il peut dans l’horizon mythique de Saint-Florent-le-Vieil. J’en connais d’ailleurs qui en viennent à déposer une annonce chez le boulanger de leur quartier afin qu’au moins l’information parvienne aux oreilles de leurs concitoyens. À ceux-là, la patrie littéraire reconnaissante. Tuez-les tous, Angot reconnaîtra les siens (parole d’évangile).
Mais je prends du retard : octobre est déjà bien entamé, la pluie de médailles de novembre déjà programmée, et la rentrée de janvier se prépare déjà dans les officines (Entendez-vous dans les salons / Mugir ces féroces publicistes / Ils viennent jusque dans vos bras / Manœuvrer vos livres et vos achats). Cela dit, mieux vaut pour moi ne pas claironner trop haut : je n’ai pas essuyé toute la grêle de septembre. Je ne suis pas le seul, soit, mais c’est là malingre consolation. Comme je suis d’humeur fringante et positive, je décide pourtant ce jour d’épargner mes semblables, mes frères : j’ai trié le bon grain de l’ivraie et ne vous donnerai à déguster ici que d’incontestables nourritures.
*
Chapeau bas pour commencer aux éditions Joëlle Losfeld. Entre la publication (enfin !) des œuvres de Paula Fox (Le dieu des cauchemars, Personnages désespérés), et celle du nouveau roman de Dominique Mainard, l’éditrice confirme son rôle d’aiguillon défricheur. Paula Fox a beau être une vieille dame, ses livres résonnent d’une modernité éclatante au regard de ceux que quelques-uns de nos trentenaires nationaux et souvent savamment coiffés offrent à la pâture littéraire. On retrouve chez elle ce qui fait bien souvent le charme de la littérature américaine, ce quelque chose de lointainement féroce, désemparé, brut, et au bout du compte peu ou prou faulknérien. Nous devons à Jonathan Franzen, l’inoubliable auteur des Corrections (L’Olivier) de l’avoir redécouverte, elle dont il dit qu’elle fut pour lui « le guide indispensable ». C’est le génie paradoxal de ce peuple que d’engendrer à la fois un Bush et un Faulkner, une Britney Spears et une Ella Fitzgerald : gageons que les seconds éclipseront toujours les premiers, sur terre comme au ciel. L’aigreur de mon propos sur les trentenaires dont je suis ne doit pourtant pas occulter certains d’entre eux, à commencer, donc, par Dominique Mainard (Le ciel des chevaux), qui confirme en cette rentrée la beauté sereine et mélancolique de son écriture, d’où n’en finissent pas de sourdre les parfums de l’enfance : plonger dans Mainard, c’est s’immerger dans le conte de ces enfances qui ne passent pas, loin des sucreries coutumières. Dans le registre de l’enfance blessée, il est important, urgent, salvateur, de lire Henry Bauchau : son Enfant bleu, (Actes Sud) est sans doute un des livres les plus profonds de l’automne, et l’écrivain belge déploie son antienne de la souffrance et de l’espérance comme jamais peut-être il ne le fit. Du côté des écritures sensibles et contenues, il faudra aussi entrer dans Virginia de Jens Christian Grondahl (Gallimard). Fidèle à sa manière très en sourdine d’épurer le sentiment, l’écrivain danois, traduit depuis un an seulement en France, confirme le succès de Bruits du coeur, paru l’an dernier, et offre avec ce court récit dramatique une lecture au classicisme parfait et à l’émotion tenaillée.
J’ignore par ailleurs ce que feront les conseils de classe susnommés, mais il semble difficile de ne pas réserver quelque égard définitif à Alain Fleischer, qui publie au Seuil un roman dont je m’étonne que les maîtres du Goncourt ne l’aient pas même retenu dans leur première sélection, et dont on sait pourtant déjà que l’histoire le retiendra comme un des regards les plus profondément mystérieux et subtils sur l’essentialisme totalitaire (La hache et le violon). En regardant la fin du monde commencer sous sa fenêtre, le récit nous aspire dans des courants d’air d’angoisses et d’absurde, tandis que passent, entre deux effluves d’Europe centrale, silencieuses et brisées, les ombres de l’humain. L’écriture de Fleischer est absolument somptueuse, d’une richesse orchestrale, métaphorique et poétique devenue trop rare dans la littérature française contemporaine. Et puisque nous évoquons presque malgré nous les vagues résonances politiques de la rentrée romanesque, difficile de ne pas songer à Jean-Paul Dubois, qui offre avec Une vie française (L’Olivier) une fresque doucement pessimiste et lointainement sociologique de la deuxième partie du vingtième siècle français. Un individu ordinaire déambulant un demi-siècle d’histoire hexagonale : l’idée n’a certes rien d’original. Mais on en sent ici la nécessité biographique, d’où quelques très jolis moments. Dubois excelle notamment dans la peinture des relations familiales, parentales, conjugales, amoureuses : partout où l’être doit communiquer avec ses semblables, l’homme devient timide, pudique, incertain, et c’est souvent très touchant. Certes l’impression de glisser sur les événements, renforcée par un usage un peu artificiel des différents présidents de la Vème république (dont les noms égrenés servent à chapitrer le livre), émousse un peu notre émotion, mais enfin, mené avec maestria, c’est redoutablement efficace. Dans la même veine générationnelle et nostalgique, Marc Lambron (Les menteurs, Grasset), toujours aussi brillant, livre un récit plus enlevé que de coutume. Il pose sur les années qui passent un regard empreint d’une humeur émue et auto-corrosive, et si l’on peut parfois s’agacer de quelques concessions à l’air du temps, il demeure un écrivain de la plus belle élégance. Comme pour Dubois pourtant, on aurait aimé que l’émotion vienne parfois nous saisir avec plus de rudesse, l’usage du grincement de dents étant parfois excessif : comme si la distance nécessaire à ces écrivains cinquantenaires n’était pas encore suffisante pour que l’émotion s’y fasse ronde et pleine. Daniel Rondeau (Dans la marche du temps, également chez Grasset) est autrement plus ambitieux – y compris pour le lecteur, si ne le rebute pas la perspective de corner mille pages. Ce n’est même plus un roman-fleuve, mais le fleuve d’un monde déjà retiré qui vient se jeter dans les estuaires de l’histoire. Il y a du réalisme à l’ancienne là dedans, et ce Rondeau alla Zola, comme l’écrit joliment François Reynaert, peut tout aussi bien vous emporter dans ses éboulis que vous figer dans ses complaisances. Au gré des événements, l’écriture se teinte de perfection classique (Rondeau est un spécialiste de Morand) et ou complaisance formelle (il est aussi maître ès Hallyday). Comme Dubois, comme Lambron, Rondeau mène la danse du bilan, et c’est parfois une danse du ventre, avec ses petites démagogies et ses grandeurs lascives. L’ancien militant de la Gauche prolétarienne a de toute évidence tourné la page, mais sans qu’aucun espoir, tout juste la vague espérance d’un homme conscient des explosifs qu’il recèle, ne vienne rallumer la mèche éteinte. Au bout du compte, cette peinture du siècle, qui semblait à certains une gageure, nous laisse sur une intense impression de vide : mais c’est le vide de l’étourdissement, l’impitoyable effet de miroir entre l’immensité de l’aventure humaine et la petitesse de ses acteurs. J’ai parlé plus haut d’Alain Fleischer en omettant de parler musique, alors que c’est dans sa corolle que se déploie le roman. Cela m’aurait d’ailleurs permis d’enchaîner tout en fluidité sur Christian Gailly (Dernier amour, éditions de Minuit), peut-être le seul écrivain français à écrire véritablement comme on soufflerait dans un sax. La musique continue donc de structurer cette prose accidentée qui fit merveille déjà dans Un soir au club ou dans Be-bop. Alors qu’elle débouche chez Fleischer sur quelque chose d’absolument étrange, bouffon, terrible, parfois combattant et militaire, elle se fait chez Gailly hésitation, inconstance, quasi-bégaiement. À cet écrivain-là, je n’en finis pas de tirer ma révérence, appréhendant chaque fois des leçons de concision que je m’empresse de ne jamais respecter. À l’école des émotions tirées au couteau, blanches et chaudes comme l’indicible, Gailly est un maître. Dernier amour est donc un Gailly-type, et l’on peut bien s’attendre à ce qu’il en soit ainsi chaque année. Mon problème étant que, chaque année, je referme mon Gailly en proclamant que c’est le meilleur Gailly. Mais là je vous le jure, vraiment, c’est le meilleur – jusqu’à l’année prochaine, s’entend. Bientôt, nous nous précipiterons chez notre libraire le jour où paraîtra le nouvel opus, comme nous le faisons rituellement tous les ans avec le même et incommensurable plaisir pour ce bon vieux Philip Roth (La bête qui meurt, Gallimard). Égal à lui-même, Roth l’est. Mais justement : on aimerait parfois qu’il le soit un peu moins. Être meilleur que nous tous l’amuse manifestement, mais nous sommes en droit désormais de lui demander d’être meilleur que lui-même. Via le maître, retour, donc, en l’Amérique, pays qui, décidément, n’en finit pas de bousculer et souvent de dominer les lettres terriennes. Difficile de ne pas évoquer Rick Moody (L’étrange horloge du désastre, recueil de nouvelles paru chez Rivages, et A la recherche du voile noir, à l’Olivier). Moody est sans doute, avec Franzen et quelques autres, ce qui se fait de plus brillant et de plus explosif aujourd'hui aux États-Unis (quoiqu’il ne faudra jamais oublier l’inouï Tout est illuminé, de Jonathan Safran Foer, paru il y a un an ; ce garçon n’a pas même mon âge et porte déjà l’habit des classiques : scrogneugneu.)
Mais c’est quand même très injuste de me demander d’écrire un papier sur la rentrée littéraire. Notamment pour ceux qui ne sont pas cités ici, et que j’ai tant aimés, et qui le mériteraient tant. Je suis actuellement plongé dans La mort de l’oeil, du mutin Zagdanski (Maren Sell éditeurs). Les amateurs de cinéma sont invités à se précipiter sur le « Zag », lequel, comme à son habitude, ne laisse pas son lecteur de marbre. Ce qui me donne l’occasion de saluer la renaissance réussie et prometteuse de Maren Sell, directrice des mythiques éditions Pauvert et récemment remerciée par Fayard, auguste maison qui s’acharne malheureusement trop souvent à poursuivre son entreprise familière de racolage. Maintenant, je conçois plus qu’aisément qu’on ne s’intéresse guère aux dernières et ultimes nouveautés. En ce cas, convoquons les mânes des grands anciens et ne craignons pas d’être farouchement anti-jeunes : les inédits d’Antoine Blondin (Premières et dernières nouvelles, à La Table Ronde), ceux de François Mauriac (D’un bloc-notes à l’autre, chez Bartillat), cinglant à souhait et plus vivant que jamais : la mauvaise foi d’un chrétien aussi impitoyable ne peut qu’entraîner notre délectation. Et enfin l’intégrale des œuvres d’Antonin Artaud, dans la collection « Quarto » de Gallimard. Manière d’entrer par la grande porte dans l’exiguïté de la petite redoute littéraire française.
***

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)
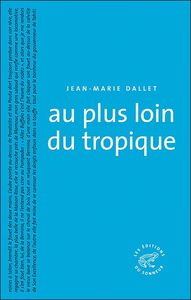

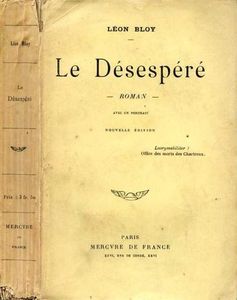


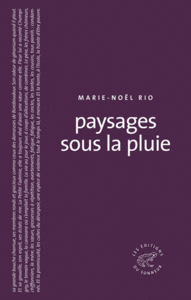


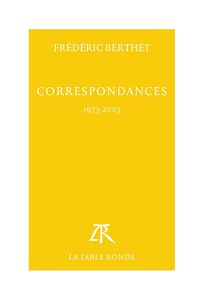





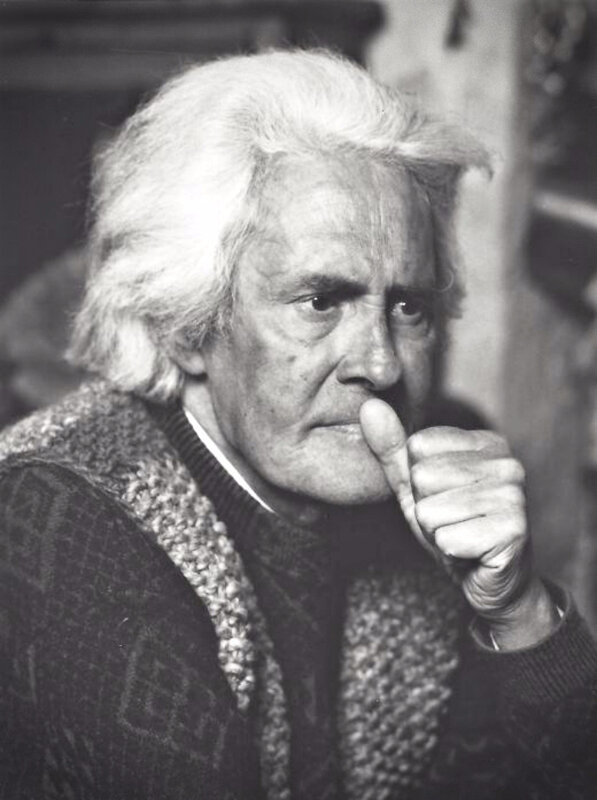
/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)